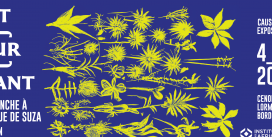« Il faut rappeler que peu de choses prédisposaient les Antilles à l’édition, du fait de leur histoire : sociétés tournées essentiellement vers la production agricole. Les premières imprimeries viennent du besoin administratif de communiquer : publications d’affiches, de gazettes, essentiellement pour la vente d’esclaves, puis avec l’abolition de l’esclavage, viennent des journaux d’opinion mais aussi parfois des œuvres littéraires publiées à compte d’auteur. »
Quelles sont les principales maisons d’édition aux Antilles ?
Désormeaux (Martinique) créée en 1971 par Émile Désormeaux, MGG (pour Martinique Guadeloupe Guyane) créée en 1972 par Tony Delsham et devenue Martinique Éditions en 1999, Jasor (Guadeloupe) créée en 1985 par Hubert Jasor puis reprise par sa fille Régine Jasor, Ibis Rouge (Martinique, Guyane, Guadeloupe) créée en 1995 par Jean-Louis Malherbe, et Desnel (Martinique) créée en 2002 par Jean-Benoît Desnel.
Y a-t-il des politiques éditoriales et thématiques bien précises ?
Il faut souligner le courage d’un pionnier : Émile Désormeaux. Comme le rappelait Jack Corzani dans le Dictionnaire Encyclopédique Désormeaux, la première véritable maison d’édition n’est apparue en fait aux Antilles qu’en 1971 ; c’est la maison d’édition Désormeaux avec une véritable politique éditoriale, une infrastructure, des salariés, etc. Émile Désormeaux était concessionnaire des éditions Bordas quand, en 1971, il sort un fascicule sur l’histoire des Antilles. La même année, il entreprend la publication d’un ouvrage conséquent, L’Encyclopédie antillaise (en six volumes), qui dressait pour la première fois un bilan culturel des Antilles. Les 2 premiers volumes sur la littérature sont signés par Jack Corzani, puis suivent les autres volumes sur la flore, la faune, la gastronomie, l’économie, la démographie. Le succès est d’autant plus remarquable que Désormeaux est concurrencé par les grosses maisons d’édition parisiennes qui ouvraient des antennes dans les DOM. Désormeaux réédite Fab’ Compè Zicaq de Gilbert Gratiant (grand succès), publie des encyclopédies telles La Cuisine créole de A à Z (6 volumes), L’Univers guyanais (5 volumes), le Dictionnaire de la langue créole (3 volumes), l’Histoire des Antilles-Guyane par l’image (6 volumes) et le Dictionnaire Encyclopédique Désormeaux (7 volumes et 2 thésaurus, édité de 1992 à 1999). Il publie la thèse de Jack Corzani La Littérature des Antilles-Guyane françaises en 1978. Il publie également Antilles d’hier et d’aujourd’hui, une série d’ouvrages qui reprend l’ensemble de l’évolution de l’univers antillais, du début de la colonisation jusqu’à nos jours, en faisant appel à la fois aux chroniqueurs du passé et aux chercheurs modernes. Cette série d’ouvrages aborde à la fois le milieu naturel des Antilles, faune, flore, vie marine, ainsi que leur Histoire. On peut dire que dès le début, finalement il est peu préoccupé par la rentabilité. Son souci est d’œuvrer à la connaissance de la culture antillaise. Il fait école, et en Guadeloupe un groupe de jeunes crée les éditions Jeunes Antilles, mais l’aventure dure peu. Il est à noter que les ouvrages chers, de luxe, très étonnamment se vendent mieux que les tirages traditionnels. Cela tient probablement d’un désir de connaissance, car les ouvrages de ce type n’existaient pas, notamment pour le cursus scolaire.
Désormeaux, qui a une politique d’édition tournée vers l’encyclopédie, a fait des émules, notamment les maisons d’édition dont j’ai parlé plus haut, mais qui publient en grande partie des romans et des recueils poétiques. Jasor a un auteur phare, Max Rippon, poète et romancier ; plus exactement, depuis 2002, il écrit ce qu’il nomme « racontage », entre roman et conte. Desnel a un auteur phare, Suzanne Dracius. Ces deux auteurs travaillent la question de la mémoire pour inventer un a-venir en prise avec la réalité. Tony Delsham, écrivain, essayiste et journaliste, a lui-même fondé sa propre maison d’édition ; il s’édite lui-même. C’est l’auteur le plus lu en Martinique et Guadeloupe. On peut consulter leurs biographies et leurs œuvres, notamment, sur le site « île en île » de Thomas Spear.
Ces maisons d’édition antillaises se soucient peu d’être en concurrence avec les maisons d’édition hexagonales, elles choisissent librement leurs auteurs et leurs politiques éditoriales. Elles tentent d’ouvrir la publication à des auteurs qui seraient peut-être moins compris dans l’hexagone, voire refusés. Ces maisons prennent en compte des questions pertinentes des Antilles, allant de la question de l’identité à celle de l’altérité. Elles travaillent également sur la stylistique en rapport avec le fond. Si certaines à leur début, notamment les éditions Jasor, favorisaient les productions en créole (pour défendre cette langue), désormais elles ne s’enferment ni dans un combat ni dans une école stylistique. Le style pour le style est ce que l’on peut parfois reprocher aux maisons d’édition hexagonales (des critiques tels que Ceccaty sont revenus de cette idolâtrie du style qui frisait parfois l’exotisme à cause de l’empreinte du cocasse dans les textes). Les maisons d’édition antillaises publient ce qui leur plait et leur paraît pertinent. Les questions d’identité, de mémoire, sont bien sûr prises en compte, mais peut-être de manière plus pragmatique pour la population antillaise ; elles ont une certaine vocation anthropologique. Le cocasse, que l’on trouve souvent dans la créolité, n’est pas leur préoccupation. Pour faire une comparaison, l’article que vient de publier Ernest Pépin « Serons-nous capables de dire, nous aussi : YES WE CAN ! » (article qui questionne de manière très pragmatique les réalités antillaises, les mœurs, les manques, les atavismes, etc.) et que l’on peut lire sur le site de Madinin’art, et celui de Glissant et de Chamoiseau « L’Intraitable Beauté du monde » (ainsi que « Quand les murs tombent »), rejoint la différence que l’on peut trouver entre les textes édités dans l’hexagone et ceux édités aux Antilles. En somme, il y a une différence de regard, de positionnement et d’intérêt. Mais, cela ne veut pas dire que tous les textes édités dans l’hexagone ou aux Antilles sont intéressants et ont une valeur littéraire ! Je ne relève que les caractéristiques dominantes.
Quels sont les domaines privilégiés (enfance, publications scientifiques, essais etc.) ?
S’il y a des domaines communs aux différentes maisons d’édition, tels le roman, la poésie, le conte, l’histoire, la littérature jeunesse, Ibis Rouge et Jasor publient également des essais, des ouvrages de linguistique créole, des ouvrages touristiques, des biographies, du théâtre, des ouvrages thématiques (danse, cuisine, botanique…). Il est à noter que Jasor s’est ouvert à la co-publication avec les Presses Universitaires de Bordeaux (PUB) pour les actes d’un colloque international que j’avais organisé à Bordeaux (Transmission et théories des littératures francophones – Diversité des espaces et des pratiques linguistiques, 2008) et qu’Ibis Rouge est très diversifié, trop diraient certains, car ces éditions publient également des BD et des actes de colloque ; de plus, Didier Malherbe, via l’association « La Plume Guyanaise » et un centre de formation « Ibis Rouge Formation » s’inscrit dans la défense des métiers du livre (libraire, éditeur, bibliothécaire) pour protéger le Livre. Les éditions Desnel ouvrent largement leur catalogue à des anthologies dont Hurricane, Cris d’insulaires (Prix Fetkann en 2005 décerné à Paris), anthologie poétique d’inédits coordonnée par Suzanne Dracius, et Memories, une autre anthologie, préfacée par Alain Mabanckou et coordonnée par Suzanne Dracius, regroupant trois auteurs caribéens : Jacques Roumain, Nicolas Guillén et Langston Hughes. Par ailleurs, Desnel s’intéresse beaucoup au jeune lectorat (il veut capter le lecteur dès son plus jeune âge pour l’amener à poursuivre son travail de lecteur) ; il a à cœur de présenter des ouvrages attractifs : textes formateurs sur l’histoire, rapport sympathique au texte, bel ouvrage, iconographie soigneusement choisie, etc. Désormeaux, s’il a publié des romans et récits, des contes et poésies (notamment les très célèbres Fab’ compè Zicaque de Gilbert Gratiant et Pawol en bouch de Hector Poullet), des ouvrages sur l’histoire et la littérature, des ouvrages scolaires, des ouvrages sur la culture antillaise (cuisine, santé, plantes, etc.), a cette particularité d’avoir publié des encyclopédies inégalables. Tony Delsham, Éditions Martinique, traite de questions sociales, de mœurs, de civilisation, à travers ses romans, pièces théâtrales et essais.
Editer aux Antilles est-ce du militantisme culturel ou une aventure commerciale ?
Ni l’un ni l’autre ; c’est un choix d’éditeur, c’est le désir de faire quelque chose qui a du sens. Je constate que cette question ne serait jamais posée à un éditeur hexagonal. Un éditeur a envie de faire quelque chose, envie de proposer des textes porteurs, a envie de s’inscrire dans le débat culturel. Si l’on veut parler de militantisme, il s’agit simplement d’une question de citoyenneté, d’homme.
Comment expliquer que le plus populaire des romanciers martiniquais, Tony Delsham, ait longtemps édité lui-même ses livres ?
Il a choisi, comme il le dit, ce mode d’édition pour être totalement libre. Cependant, cette liberté se paie assez cher, car comme sa maison d’édition n’a qu’un seul auteur, il n’est pas considéré comme un éditeur et de ce fait son catalogue n’est guère pris en compte. Dans l’histoire de l’édition, les auto-publications, ou publication à compte d’auteur, ont toujours été suspectes. Mais Tony Delsham est l’auteur le plus lu en Martinique et en Guadeloupe ; ses ouvrages sont toujours attendus avec impatience. Cela tient au fait qu’il traite des questions contemporaines en prise avec la réalité des Antilles. N’oublions pas qu’il a publié des bandes dessinées, qu’il a lancé en 1972 Martinique Hebdo, qu’il a été Rédacteur en chef du Naïf jusqu’en 1982 et à partir de 1990 Rédacteur en chef de Antilla. Les titres de ses romans sont très évocateurs : Panique aux Antilles (1985), L’Impuissant (1986), Papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison ? (sur le sida, 1997 et porté à l’écran par Christian Lara en 2001), Négropolitains et euro-blacks (2000), et le très célèbre Tribunal femmes bafouées (2001). Il a également écrit une somme historique Le Siècle (Tome 1 : Fanm Dèwó en 1993, tome 2 : Antan Robè en 1994, tome 3: Lycée Schœlcher en 1995, tome 4: Choc en 1996, tome 5: Dérives en 1999).
Les romanciers de la créolité et la plupart des auteurs antillais sont le plus souvent exclusivement édités en métropole. Ne pas être édité aux Antilles est-ce une marque de reconnaissance ?
Comme je viens de le souligner, Tony Delsham, en décidant de se publier lui-même, dépasse la question puisqu’il est l’auteur le plus lu en Martinique et en Guadeloupe. Il est donc très reconnu. Mais, le problème qui se pose à lui est celui de la diffusion : le plus lu aux Antilles, mais dans le monde, qu’en est-il ? Ce n’est pas l’auteur antillais le plus lu. Édouard Glissant, dont l’œuvre est monumentale, est le plus lu ; Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, auteurs de la créolité, le sont bien plus que Tony Delsham, Simone Schwarz-Bart, publiée par Le Seuil, Ernest Pépin, publié et dans l’hexagone et aux Antilles, le sont également. C’est donc une question de diffusion, d’accès aux textes. La question de l’édition est donc complexe. Il y a la question de la diffusion et celle de la représentation, de l’idée que l’on se fait des maisons d’édition. Que veut dire, pour un auteur, être accepté par une maison de l’hexagone ou par une maison antillaise ? Et que veut dire, pour un lecteur, de lire un ouvrage publié par de « grandes » maisons d’édition et de « petites » maisons d’édition qu’elles soient hexagonales ou antillaises ? Quelle légitimité leur accorde-t-on ? Cela nous renvoie également à la question de l’horizon d’attente.
Tout d’abord, pour les auteurs, la question est souvent très simple : ils envoient leurs textes à de multiples maisons d’édition et signent simplement avec ceux qui décident de les éditer. Pour les lecteurs, c’est autre chose. Cela dépend du niveau d’indépendance et d’esprit critique. Si le lecteur est souvent confronté au tapage médiatique, s’il a plus facilement accès à certains textes qu’à d’autres, il peut aussi avoir accès à des critiques, des propositions de lecture moins connues grâce à internet, à son libraire, à un réseau.
On a souvent tendance à opposer « métropole » et « périphérie » ; or, créer et faire vivre une maison d’édition aux Antilles n’est pas moins problématique que dans l’hexagone, et être publié par un gros ou un petit éditeur, peut revenir au même pour un auteur. Un auteur délaissé dans une grande maison n’est pas mieux loti qu’un auteur chez un petit éditeur ; de même il peut être confronté aux mêmes difficultés avec une maison antillaise ou hexagonale. Gallimard, par exemple, publiera dans une année une trentaine de livres, mais ne s’occupera que de quatre livres qui vont payer pour le reste ; il n’y aura pas de publicité pour les autres. L’idée du best-seller ou du roman (tel Texaco) qui peut obtenir un prix est toujours présente.
La question sous-jacente, peu exprimée mais souvent pensée, est la suivante : qui sont les auteurs authentiques : ceux publiés aux Antilles ou ceux publiés en dans l’hexagone ? En d’autres termes, la question qui se pose (et explicitement formulée par Vincent Jouve) est d’une part celle des relations entre valeurs et institutions littéraires et d’autre part celle des relations entre valeurs et textualité. La première relation (valeurs/institutions littéraires), c’est-à-dire la question de l’influence de la littérature (ce qui est donné à lire) sur les valeurs sociales, et inversement, s’étudie selon une double perspective : comment la littérature pèse sur les valeur sociales (car les textes par leur diffusion influent sur les mentalités ; la littérature n’a jamais cessé d’être envisagée comme action sur le monde) et comment les valeurs sociales pèsent sur la littérature (car la chose littéraire est modelée, voire définie, par les valeurs d’un groupe à un moment donné). La deuxième relation (valeurs/textualité), c’est-à-dire le poids et l’influence des circuits sociaux qui produisent la « valeur littéraire » selon des critères définis, doit prendre en compte tous les acteurs du champ littéraire. Ainsi, la responsabilité des maisons d’éditions, des critiques, des enseignants et des universitaires n’est pas négligeable. En ce qui concerne les enseignants, notamment les universitaires, qu’on le veuille ou non, leurs choix de corpus (je dirai nos choix puisque je suis universitaire), d’ouvrages mis au programme, confirment souvent, inconsciemment certes, la supériorité des maisons d’édition hexagonales. Il y a toujours un a priori : un auteur édité dans l’hexagone semble, ou plus exactement est considéré comme supérieur, plus grand que celui édité aux Antilles (la Polynésie, quant à elle, n’entre pas dans ce jeu en se tenant délibérément à l’écart). Par conséquent, il y a non seulement à changer le regard, mais également à être plus vigilant (n’oublions que de « grands » auteurs, comme l’on dit, on d’abord été publiés à compte d’auteur ; cela ne veut pas dire que tous ceux qui publient à compte d’auteur sont de grands auteurs, tout comme ceux qui sont publiés par de « grandes » maisons d’édition seraient forcément de « grands » auteurs). Ce qui prime, c’est l’analyse, l’esprit critique. Même s’il est vrai qu’il est parfois difficile de se procurer des œuvres éditées aux Antilles, la littérature antillaise ne peut se limiter à ce qui est publié dans l’hexagone. Bien sûr, Gallimard, Grasset, et Actes sud (ce dernier pour Haïti surtout) sont ce que l’on appelle de grandes maisons d’édition ; elles ont une histoire, de larges épaules dans le sens où elles ont une politique de communication très solide (grâce à leur finances) et de distribution. Elles jouissent d’une très grande renommée. On a tendance à considérer que les textes édités par ces maisons sont bien plus valables que ceux édités par des maisons peu connues. C’est l’image que l’on a de ces maisons ; image entretenue par les auteurs et par les lecteurs. Le lieu de publication, participant de l’horizon d’attente, n’est assurément pas sans incidence sur le choix thématique et l’option stylistique, voire parfois sur le degré de liberté de l’auteur. Il y a des modes en littérature ; il y a eu le grand moment de la littérature sud-américaine, de la littérature russe, africaine, etc. Les éditeurs mettent en avant certaines écritures à certains moments (il serait un peu long de développer ce point) et créent un engouement. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas d’intérêt à lire ces auteurs (bien souvent il y a d’heureuses découvertes), mais tout à coup, il y a la prédominance de courants d’écriture, de mouvements littéraires, voire d’écoles.
En ce qui concerne la littéraire antillaise, il y a eu un engouement pour la créolité (il faiblit depuis quelques années). Certes, ceux qui ont écrit Éloge de la créolité (d’abord conférence prononcée en Seine Saint-Denis, puis édité aux éditions Gallimard) n’ont fait que reprendre ce qui se faisait déjà depuis bien longtemps avec des auteurs tels Jacques Roumain ou Simone Schwarz-Bart (mais ces derniers n’avaient pas posé ou décrit les lignes directrices de leur écriture dans un manifeste ; ils avaient écrit leurs œuvres sans se soucier de les expliquer), mais ils ont créé un événement qui les a mis sous les projecteurs. Mais ne soyons pas aveuglés par les feux de la rampe et gardons notre lucidité.
De quelle reconnaissance parle-t-on ? Est-ce simplement celle des « grandes » maisons d’édition et celle des « grands » medias ? Est-ce celle des différents lectorats et critiques ? Et que veut dire reconnaissance ? Bien sûr, la reconnaissance est diverse et, dit-on, l’histoire tranchera. Mais, comme je le disais, ne soyons pas aveuglés. Ainsi, je prendrai un cas : la parution la même année, en 2002, de deux textes Biblique des derniers gestes de Chamoiseau et Marie La Gracieuse de Max Rippon (je dis « textes », car Chamoiseau ne voulait pas que la catégorisation « roman » soit apposé à son texte, mais l’éditeur a gardé la catégorisation « roman », et Rippon a créé lui-même la catégorie « racontage » qui a été accepté par son éditrice), l’un chez Gallimard, Biblique des derniers gestes, l’autre chez Jasor, Marie La Gracieuse. Quel est celui dont on a parlé ? Biblique des derniers gestes, bien sûr ! Or, Marie La Gracieuse me parait bien plus porteur que Biblique des derniers gestes. Ni roman, ni conte, mais “racontage”, Marie La Gracieuse propose une forme nouvelle de la transmission des connaissances dans l’espace culturel antillais. Les propositions découlant du « jeu » autour du conte et du roman dans Marie la Gracieuse sont assurément d’ouvrir une voie différente de celle la créolité, d’interroger davantage et différemment la tradition, de refuser le « sé konsa nou yé, sé konsa nou vlé rété » (c’est comme ça que nous sommes, c’est comme ça que nous voulons demeurer), et par conséquent de refuser le cocasse, d’inverser le rapport figé à la tradition en s’appuyant précisément sur elle. Le racontage mêle roman et conte, c’est-à-dire pratique culturelle dite « savante » et pratique culturelle dite « populaire ». Bien que le conte existe dans toutes les cultures, il est perçu aux Antilles, en l’absence de mythologie fondatrice, comme élément fondamental de la culture, de l’identité ; cette perception, cette considération réelle et imaginaire, est vraie non seulement dans l’espace antillais, mais aussi caribéen. Par ailleurs, nous entendons bien « racontage » comme « ra–conte–age » ; ce qui est ici préfixe « ra–» induit la notion même de ressassement qui vient doubler ou redoubler le ressassement du genre du conte, qui est lui-même production d’une mémoire, et le suffixe « –age », la manière de faire. Par conséquent, les questions qui se posent sont : comment révéler le passé, le prendre en compte, sans en être prisonnier ? Quelle est la manière de vivre et de produire du futur avec le ressassement, les traditions, l’atavisme et le fonds culturel ? Racontage signifie également « petite chose de chez nous », « petite chose peu sérieuse », ce qui permet à l’auteur de poser, de prime abord, l’humilité de sa parole et de son écrit. Biblique des derniers gestes, pour sa part, est également un conte, mais aussi un roman-somme, dans la lignée des œuvres d’Édouard Glissant et particulièrement de Tout-monde paru en 1993, par la traversée du/des monde(s). Les deux textes ont une dimension christique, mais si Biblique des derniers gestes frôle le territoire de la mélancolie, il s’y dérobe et demeure dans celui de la nostalgie. Balthazar a parcouru le monde, a participé à toutes les luttes anti-coloniales (il a 15 milliards d’années), puis fini replié dans sa maison et son jardin. Il renonce à l’extérieur et cultive son intériorité. Boualem Sansal, dans Petit éloge de la mémoire, paru chez Gallimard en 2007, écrivait que la nostalgie est certes une richesse, mais si l’on ne sait pas où est son pays, ce qu’il a été, ce qu’il est devenu, comment et pourquoi on s’en est éloigné, et par quel fil on s’y rattache encore, la nostalgie mène à l’errance, à l’apathie, à la colère, au renoncement. Balthazar, étant du côté de la nostalgie, traverse toutes ces phases.
Ce qui différencie également ces deux textes, c’est le rapport à la femme. En accord avec la dominante de l’espace culturel guadeloupéen, Balthazar Bodule-Jules développe une méfiance certaine, et originelle, à l’encontre des femmes. De plus, dans Biblique des derniers gestes, les relations hommes/femmes, surtout dans le champ sexuel, sont négatives et les stéréotypes y sont nombreux prouvant ainsi que Balthazar Bodule-Jules n’arrive pas à accéder au sens de l’autre. Si comme le dit Boualem Sansal « la domination n’est pas l’amitié », la domination ne permet assurément pas l’accès à l’altérité. En revanche, dans Marie La Gracieuse l’horizon d’attente est détruit à travers la figure de la baigneuse de morts : Marie la Gracieuse est une baigneuse de morts, une quimboiseuse, mais surtout elle est jeune. C’est un fait si nouveau dans la littérature antillaise qu’il mérite d’être souligné. Elle n’est pas du côté des Mans (des grands-mères), car elle est volontairement et explicitement sexuellement définie. Autre évitement de l’horizon d’attente : la figure de la mère et celle du fils. Rippon, qui a longtemps confondu la figure de la mère et celle de la femme dans ses poésies, ne magnifie plus l’image de la mère ; ainsi, Man Frida, la mère de Monawdèl, n’est pas particulièrement sympathique : médisante, envieuse, rancunière, possessive, avare, mesquine. En revanche, la figure de la mère est encore magnifiée dans chez Chamoiseau. Le protagoniste masculin majeur de Marie La Gracieuse, Monawdèl, qui pourrait aisément rejoindre la figure de Ti Jean (le masculin « débouya » qui obtient tout, même la fille du roi dans certains contes) n’est pas magnifié, bien au contraire. L’auteur rend compte explicitement de l’aveuglement de Monawdèl qui prend sa source dans l’assurance de sa position d’homme. De plus, dans ce racontage, des couples se forment véritablement dans le respect mutuel, dans l’amour.
Ces deux textes me semblent symptomatiques de deux orientations d’écriture et de transmission, de deux modèles structurant l’imaginaire et par conséquent le rapport au monde. Si pour Biblique des derniers gestes il s’agit de la « vie réussie », privilégiant l’identité, pour Marie La Gracieuse il s’agit de la « vie bonne » privilégiant l’altérité. Marie La Gracieuse fait partie de cette famille littéraire qui privilégie le signifié au signifiant, qui est proche d’un certain esprit philosophique qui est avant tout un art de vivre. Marie la Gracieuse invite fondamentalement le lecteur, et surtout le lecteur antillais, à découvrir et à dépasser ses propres abîmes, ses propres tentations, ses propres tabous. Il est vrai que les relations hommes/femmes sont, pour de multiples raisons, dans la société antillaise, un point de cristallisation de celle-ci, créant un mortifère quotidien relevant de l’impossibilité à vivre avec l’autre. Si Balthazar Bodule-Jules symbolise le combat anti-colonialiste, Marie la Gracieuse symbolise, quant à elle, la question du rapport de la femme et de l’homme (question des plus pertinentes actuellement aux Antilles) ; elle est l’archétype de la bonté comme « arme miraculeuse » (nous savons que faire correctement les choses, c’est d’abord faire des choses généreuses). De même, si Balthazar Bodule-Jules est l’incarnation de la rébellion s’achevant sur le renoncement, le repli, Marie la Gracieuse est celle de l’humanisme. La position que choisit Rippon amène le lecteur à être totalement concerné, car elle touche et aide personnellement en tant qu’homme réel. Comme le dit Tzvetan Todorov, dans La Littérature en péril, paru en 2007 aux éditions Gallimard, on étudie mal le sens d’un texte si l’on s’en tient à une stricte approche interne, alors que les œuvres existent toujours au sein d’un contexte et en dialogue avec lui ; il faut s’interroger sur la finalité ultime des œuvres que nous jugeons dignes d’être étudiées et ne pas simplement s’arrêter à la technique, à la stylistique. Todorov dit que lui-même avait contribué à cet enfermement du texte en tant que linguiste et qu’il était temps de revenir à la totalité du texte. Pour être plus claire, je dirai qu’il s’agit de revenir à cette double unité : le fond et la forme ; l’auteur et le contexte. Un auteur peut évidemment avoir un style remarquable, inventif, novateur, mais développer des croyances (ou idées) qui peuvent nous laisser perplexes (tel était le cas de certains textes de Céline, pour ne prendre que le plus connu).
Mais pour finir, je voudrais rappeler également qu’il y a d’autres maisons d’édition qui ont beaucoup œuvré pour la connaissance de la culture antillaise. Bien que basées en France hexagonale, elles ont fondamentalement une politique d’édition tournée vers les Antilles et l’Afrique. Ainsi, Présence africaine, créée par les époux Diop, a édité, entre autres, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Paul Niger, Guy Tirolien. Mais cette maison souffre depuis bien des années d’un essoufflement certain et s’est davantage tournée vers l’Afrique. Toujours dans l’hexagone, les éditions Vents d’ailleurs publient de la littérature, des livres jeunesse, des documentaires et des livres d’art ; créées à Fort-de-France en 1994, elles sont actuellement installées dans le sud de la France. Elles établissent des passerelles entre le lectorat du Nord et les modes d’expressions artistiques et littéraires du Sud, de l’Afrique, des Amériques noires et de la Caraïbe. Leur politique éditoriale, telle qu’ils la définissent, « bouscule les idées reçues de la vision de l’autre au travers du prisme des cultures dominantes et contredit les imaginaires familiers ». Jutta Hepke et Gilles Colleu ont la conviction qu’une nouvelle écriture de l’histoire des peuples du monde est une nécessité absolue. Les Éditions Riveneuve Continents, créées en 1999, éditent des romans et des essais, mais ont également une revue du même nom, dirigée par Alain Sancerni (de 2 numéros par an, elle passe à 3, voire 4 numéros par an) dans laquelle paraissent des articles de fond, des articles universitaires, des entretiens, des textes libres (poésie ou prose poétique) et des comptes rendus d’ouvrages.
Mme Dominique Deblaine, Maître de Conférences, Université Bordeaux IV.
Guadeloupéenne, Maître de Conférences à l’Université Montesquieu Bordeaux IV. Elle a écrit divers articles sur la littérature antillaise, dirigé des ouvrages universitaires, Transmission et théories des littératures francophones – Diversité des espaces et des pratiques linguistiques (Éd. P.U.B./Jasor, Bordeaux/Pointe-à-Pitre, 2008), Entre deux rives, trois continents (Mélanges offerts au Professeur Jack Corzani ; Éd. M.S.H.A.), publié des nouvelles : Champ d’Arbaud (dans la revue Écriture, n° 44, Lausanne, 1994), L’Errant, le Désirable (dans Entre deux rives, trois continents, Éd. M.S.H.A., Bordeaux, 2004), Déshérence (dans Riveneuve Continents, n°2, 2005), Impasse Montout (à paraître dans Riveneuve Continents, 2009), préfacé les œuvres théâtrales de Jesùs Carazo, romancier et dramaturge espagnol.) ainsi que le recueil poétique de Max Rippon Débris de Silences (Éd. Jasor, Pointe-à-Pitre, 2004).
Rédaction (Afiavimag)